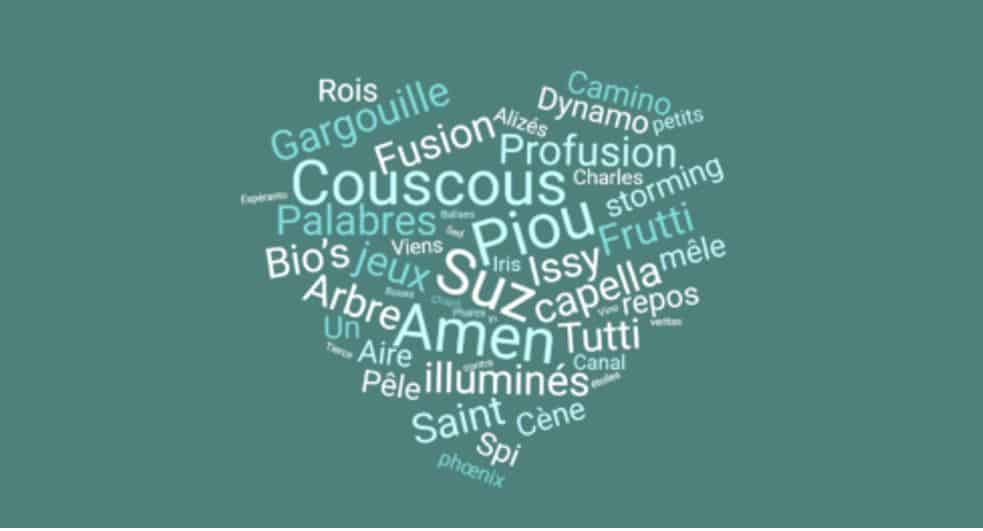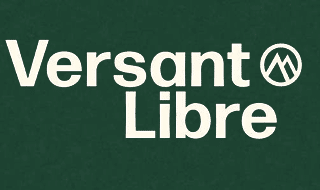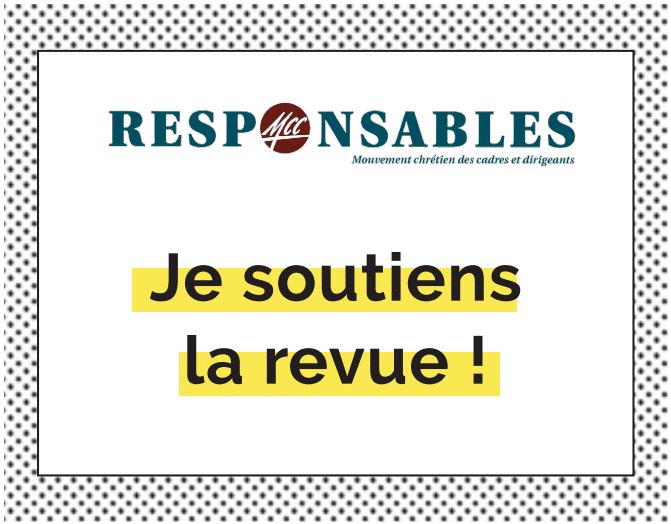Benjamin Cambresy
Créateur d’identité et de nom de marque indépendant, collaborateur de l’agence Fondamenti

Benjamin Cambresy
Créateur d’identité et de nom de marque indépendant, collaborateur de l’agence Fondamenti
analyse
Temps de lecture estimé : 10 minutes
Au recommencement était le nom
Un changement de nom d’organisation relève d’un choix stratégique qui s’inscrit dans une démarche globale de renouveau identitaire, répondant à un certain nombre de critères. Analyse par un expert, créateur d’identité et de marque.
Chaque année environ 15 000 entreprises changent de nom. Autrefois gravé au fronton des locaux et traversant imperturbablement les générations, le nom d’entreprise est depuis 40 ans sujet à des modifications plus fréquentes, favorisées par des mutations économiques structurelles à partir des années 1980 (mondialisation, fusion ou acquisition, évolution rapide des marchés, digitalisation, etc). Plus fréquente, l’opération de renommage est pourtant loin d’être badine. Au croisement d’enjeux commerciaux, stratégiques, managériaux, il s’agit généralement d’une opération lourde de sens pour une entreprise, dont il est essentiel de comprendre les motifs, l’efficacité réelle et les conditions de réussite.
Le nom comme support universel de l’identité
A la question « Qui êtes-vous », la quasi-totalité des individus répondront en énonçant leurs noms (généralement un prénom et un nom de famille selon le système de nomination devenu dominant).
Dans les sociétés traditionnelles, le nom est un symbole qui encode l’identité sociale d’un individu permettant d’indiquer son appartenance, à un clan, une famille, un groupe de parenté. Dans certaines cultures, il peut même évoluer selon les mutations de cette identité : par exemple pour marquer l’entrée dans un statut nouveau ou le passage d’un nouvel âge comme chez les Masaïs.
L’entrée dans une communauté religieuse illustre cette intrication nom-identité, à tel point que le terme baptiser est devenu synonyme de nommer : pratiquée par toutes les religions, la (re)nomination se donne à voir comme la réalisation même du changement d’identité religieuse.
Dans les sociétés modernes où les identités sont personnelles, les changements de noms sont des renouveaux identitaires à l’initiative des individus : engagement politico-religieux (Mohammed Ali), sexuel (le prénom lors d’une « transition de genre »), artistique (en se dotant d’un pseudonyme), familial (en changeant le nom qui reflète une histoire familiale intime). Inversement, le statut marital n’implique plus l’obligation de changement de nom.
Le nom peut-il façonner l’identité ?
Le nom peut parfois revêtir une influence directe sur la réalité. Chez certains peuples, le nom donne un pouvoir à celui qui l’attribue ou l’invoque. Déjà présent à l’Antiquité, le débat sur le statut ontologique des mots s’est structuré dans la scolastique médiévale entre les partisans du « nominalisme » et ceux du « réalisme » : pour les tenants du premier, les mots ne sont que des conventions de langage commodes pour désigner les éléments de notre environnement, tandis que pour les réalistes, les mots existent en soi, ils ont une réalité propre. La linguistique moderne affirmera plus tard le caractère arbitraire du langage, à l’encontre de l’approche réaliste : un mot, et a fortiori un nom, est un signe sans lien nécessaire avec la chose qu’il désigne.
Pourtant, dans la psyché collective, le nom demeure toujours associé à un destin (« nomen est omen » comme disaient les Romains). Cette croyance se manifeste notamment dans le choix du prénom d’un enfant, dont on espère qu’il présage de sa destinée. Si vous prénommez un enfant Victor, vous souhaitez qu’il devienne un Victor, c’est-à-dire un ensemble de perceptions que vous projetez sur le prénom Victor, que ce soit au travers de son étymologie victoire, d’une référence à un personnage comme Victor Hugo, à une certaine personnalité associée à la sonorité du nom, etc. Autrement dit, il y a déjà un contenu latent à ce nom qui constitue une part d’identité que l’on souhaite transmettre par le biais du nom donné.
Nom d’entreprise : une nouvelle mission sémantique
Dans le cadre de l’entreprise, le choix d’un nom est aujourd’hui entouré des mêmes précautions et réflexions que pour nos bambins. Si l’on se contentait autrefois de toponymes (Saint-Gobain, La redoute) ou de patronymes (Citroën, Michelin, Renault, ou Bouygues), la préoccupation qui domine aujourd’hui est celle de donner un sens. Le nom est chargé d’une fonction nouvelle : raconter, évoquer la raison d’être d’une entreprise, son offre, ses valeurs, sa vision du marché, sa personnalité, etc.
Pour une entreprise en mutation, renommer permet ainsi de reconfigurer son identité, de tracer les nouveaux contours de l’organisation et de sa vocation. Cela permet d’envoyer un signal fort de changement profond. On peut distinguer différents motifs d’un renouvellement de nom : élargissement du territoire d’intervention (Covoiturage devient Blablacar) ; changement de direction (Andersen Consulting devenant Accenture) ; élargissement (Français des jeux (groupe) devient FDJ United) ; rupture d’une malédiction (Orpéa devient Eméis) ; changement de statut (France Télécom devient Orange) ; changement de cible de consommateurs (Monsieur Moustache devient Odaje).
L’opération de renommage n’est toutefois pas systématiquement couronnée de succès. Dans les années 1990, Borland — fleuron américain de la conception de logiciels — avait accompagné son repositionnement vers de l’intégration et du conseil par un changement de nom de Inprise (Inprise : integration + Enterprise). Cette stratégie n’a pas été comprise et, face à la confusion créée, le choix a été fait de revenir à l’ancien nom de Borland. Il nous faut donc creuser les mécanismes à l’œuvre dans la dialecte nom-identité.
Faire du nouveau nom un discours
Le nom n’a pas de contenu propre et définitif. Pensons aux marques grand public comme Nike ou Starbucks. On constate que les références érudites à l’origine de leurs noms sont tombées dans l’oubli. Starbucks n’évoque à personne Moby Dick, pas plus que Nike ne fait germe dans les esprits les plus classiques des images de mythologie antique. En effet, au fur et à mesure qu’une marque se développe, elle se charge d’un sens qui lui est propre. Le contenu sémantique initial du nom peut même disparaître s’il n’est pas activé dans la communication de la marque (ce qui n’est le cas ni de Nike, ni de Starbucks).
Le nom ne détermine pas l’identité de l’entité qui la porte. Ou plus précisément, il ne la détermine pas seul. Outre la nécessité que l’identité projetée soit atteignable et cohérente avec la réalité de l’entreprise, la capacité transformatrice de l’opération de renommage ne tient pas au nom lui-même, mais à la capacité de l’entreprise à s’en saisir pour faire discours. Par exemple, la séparation de la branche conseil de l’entreprise comptable Andersen Consulting a nécessité une rupture symbolique forte, matérialisée par une communication sur un repositionnement de l’entreprise vers l’innovation et la technologie : le sens crypté du nouveau nom Accenture « Accent on the future », répété à l’envi, sera un levier puissant pour réussir cette transition.
Des études réalisées sur les effets des changements de nom sur les cours de bourse ont noté que l’impact positif initial était amplifié lorsque le changement était associé à une stratégie claire et lisible. Ceci corrobore le constat empirique du créateur de marque : la qualité d’un nom tient notamment à sa capacité à rendre plus performante la communication de l’entreprise.
Faire du renommage une opportunité
Une deuxième condition tient au facteur temps. La nature d’un nom change au cours du temps : d’abord perçu en soi à travers les connotations et les références qui le composent, il se charge ensuite de toute l’histoire de la marque d’entreprise.
Il en découle une fenêtre d’opportunité pendant laquelle l’identité est une page blanche qui peut se réécrire en se soustrayant plus facilement aux effets d’inertie d’une organisation. Les éventuels changements que l’on souhaite impulser à l’aide du nom sont conditionnés par ce temps court où l’identité est davantage « plastique ».
L’importance de la temporalité du changement de nom
Pour intéressant que soit un changement de nom pour une entreprise en mutation, il ne va pas de soi, notamment au regard des ressources importantes qui peuvent être engagées. Parmi les éléments d’image de l’entreprise, la particularité du nom est d’être un élément particulièrement stable qui tend à se confondre avec son identité. Si les logos peuvent être modernisés ou actualisés régulièrement et les signatures modifiées en moyenne tous les cinq ans, la durée de vie d’un nom se compte en dizaine d’années.
Un changement de nom doit donc toujours être associé à un changement significatif. Les changements trop fréquents ou insuffisamment justifiés peuvent affecter la crédibilité ou la lisibilité d’une organisation. Mais si le changement de nom est définitif, le changement de l’entreprise est en revanche souvent graduel. Nous touchons là au cœur de la difficulté : il s’agit de déterminer si le degré de changement opéré peut être considéré comme suffisamment important pour justifier un changement de nom. Ce afin d’éviter un changement de nom artificiel ou, au contraire, de repousser trop longtemps le changement d’un nom devenu obsolète ou délétère pour l’organisation.
Dans certains cas, la nécessité du changement est simple à discerner, lorsqu’un nom explicite devient en contraction avec des aspects fondamentaux de l’entreprise. La privatisation de France Télécom constituait ainsi une rupture substantielle justifiant le choix de changer de nom pour Orange. M. Moustache — spécialiste de la chaussure masculine — a adopté le nom Odaje pour se développer sur une cible féminine.
Lorsque que les changements d’identité sont graduels, discerner la pertinence d’un changement de nom est plus subtil. Il s’agit non seulement d’évaluer l’importance des évolutions déjà survenues ainsi que des évolutions à venir, mais aussi la perception de ces évolutions. Le cas de la Française des jeux (FDJ) est intéressant à ce titre, avec le choix d’une marque groupe « FDJ United » faisant hommage à la forme désormais multiple et internationale du groupe, et le maintien d’une marque commerciale FDJ reflétant une activité toujours prédominante en France. Ce choix permettait au niveau du groupe un véritable saut d’identité (internationalisation) mais le changement n’était pas suffisamment fondamental pour justifier d’effacer « FDJ ».
Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, le changement de nom a été un outil efficace pour accélérer et donner consistance à un changement profond de l’entreprise, à condition d’être porté par un discours sur le renouveau identitaire de la structure.