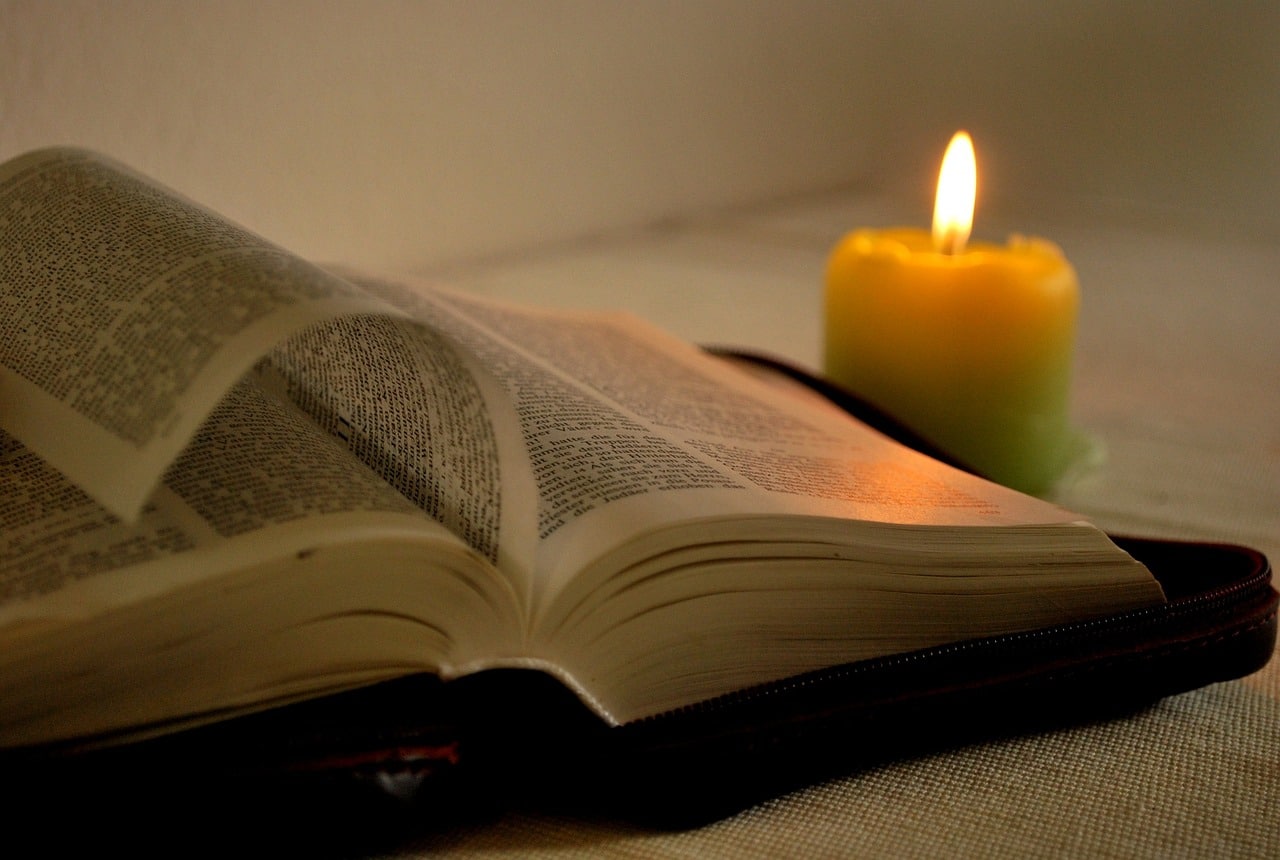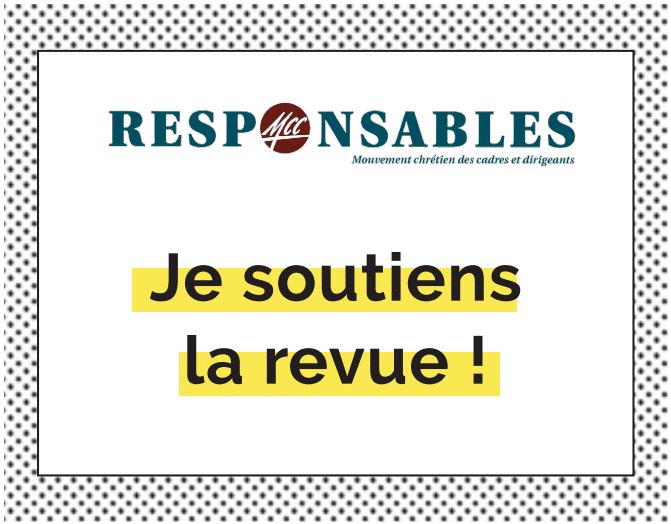Grégoire Catta sj
Docteur en théologie, maître de conférences aux Facultés Loyola Paris

Grégoire Catta sj
Docteur en théologie, maître de conférences aux Facultés Loyola Paris
enseignement social
Temps de lecture estimé : 6 minutes
Comment nommer « la doctrine sociale de l’Église » ?
Nommer comporte toujours le risque d’enfermer dans une catégorie et d’appauvrir la portée de l’objet nommé. Illustration avec la doctrine sociale de l’Eglise.
Doctrine sociale de l’Église ? Pensée sociale de l’Église ? Magistère social de l’Église ? Enseignement social de l’Église ? Discours social de l’Église ? Comment appeler cet objet particulier qui résulte de la rencontre de l’Évangile et des questions économiques, sociales et politiques et qui s’est notamment cristallisée au sein de l’Église catholique dans un ensemble de documents magistériels de différents papes et dans la promotion de divers principes comme le respect de la dignité humaine, la recherche du bien commun ou l’option préférentielle pour les pauvres ?
Nommer c’est forcément mettre l’accent sur certains aspects de l’objet au risque d’en faire oublier d’autres. Mais pour autant peut-on se passer d’un nom ? Impossible d’utiliser la phrase de plus de 80 mots ci-dessus pour décrire l’objet en question. On ne peut non plus se contenter de parler de « notre secret le mieux gardé »[1] même si c’est une image très parlante pour stimuler son étude et sa diffusion !
On ne peut se contenter de parler de « notre secret le mieux gardé » même si c’est une image très parlante
Un discours d’importance
Parler de doctrine c’est souligner l’importance et la solidité de ce qui se dit lorsque l’Église expose les conséquences sociales du message évangélique. L’expression « doctrine sociale » remonte au pape Pie XI qui, en commémorant l’anniversaire des 40 ans de la première encyclique sociale du pape Léon XIII (Rerum novarum, 1891), veut souligner son importance fondatrice et parle de « l’admirable doctrine qui fait de l’encyclique Rerum novarum, un document inoubliable » ou encore de « la doctrine sociale et économique de l’encyclique Rerum novarum »[2].
Le pape Jean-Paul II parle de la doctrine sociale de l’Église comme d’« une partie essentielle du message chrétien »[3]. Ce qui se dit dans la doctrine sociale de l’Église n’est pas périphérique et participe donc bien de sa mission d’annoncer le mystère de la foi.
Un discours qui n’a rien de doctrinaire
Mais parler de doctrine peut aussi faire penser à « doctrinaire », comme si ce qui se dit là venait uniquement d’en haut et devait s’appliquer de manière brutale. Ce serait ignorer à quel point le discours social de l’Église – pour employer la terminologie utilisée par les jésuites du Ceras en 1984 à propos des grands textes magistériels sur les questions sociales [4] – est abondamment construit sur un aller-retour entre des expériences de terrain et un travail de discernement théologique et pastoral.
Ce serait ignorer aussi à quel point ce discours s’efforce de donner non pas des solutions universelles mais des « principes de réflexion », « des normes de jugement » et « des directives d’action » [5] pour un discernement et une action forcément adaptés aux circonstances de temps et de lieu.
C’est aussi un des risques de l’emploi du mot doctrine que de croire qu’on a affaire à une parole immuable, inchangeable, fixée une fois pour toute. Jean-Paul II souligne au sujet de l’enseignement de l’Église dans la doctrine sociale qu’« il est toujours nouveau parce que sujet aux adaptations nécessaires et opportunes entraînées par les changements des conditions historiques et par la succession ininterrompue des événements qui font la trame de la vie des hommes et de la société »[6]. La fixation dans une doctrine de l’interprétation de l’Évangile pour des questions socioéconomiques ou politiques, telle qu’elle est conçue à un instant donné, n’est qu’un moment dans un processus.
Une pensée qui s’élabore dans un dialogue
C’est sans doute pour cela qu’au moment du Concile et dans les années qui ont suivi on a moins utilisé l’expression « doctrine sociale » (on ne la trouve pas ou quasiment pas dans les textes du Concile et chez Paul VI). Beaucoup – et encore aujourd’hui – lui préfèrent l’expression de « pensée sociale » ou « discours social ». Manière aussi de mieux faire percevoir que son contenu s’élabore toujours dans un dialogue et une recherche avec d’autres et notamment dans le dialogue avec la philosophie et les sciences humaines et sociales.
Mais rien n’est parfait et le risque peut venir de ne considérer cette « pensée » ou ce « discours » que comme une opinion parmi d’autres, n’engageant pas vraiment le cœur de la foi… Parler d’« enseignement social » – voire de « magistère social » comme le fait le pape François [7] – permet de souligner qu’il y a bien du contenu à recevoir et à apprendre… au risque d’oublier que ce n’est pas qu’une question de connaissance mais aussi de mise en pratique !
La richesse d’une pluralité d’appellations
Alors, comment parler de cet objet finalement bien identifié mais difficile à nommer ? Une pluralité d’appellations est peut-être une richesse permettant, en fonction des contextes d’insister sur tel ou tel aspect. L’important est bien de toujours davantage prendre conscience, à l’intérieur de l’Église et en dehors, que l’Évangile a une dimension et des conséquences sociales.
On peut conclure avec le théologien Luc Dubrulle que « les différentes dénominations de doctrine, enseignement ou pensée sociale de l’Église, désignent un dynamisme de toute l’Église qui se condense dans des textes clés du magistère, lesquels entraînent à nouveau à de la pensée et de l’action ! »[8].
***
[1] C’est le titre d’un ouvrage de présentation de la pensée sociale de l’Église en anglais, plusieurs fois réactualisé depuis une première édition en 1987. Henriot, Peter J., Edward P. DeBerri, and Hug, James E. Catholic Social Teaching : Our Best Kept Secret. New York : Orbis, 2003.
[2] Pie XI, Quadragesimo anno (1931), 10, 19.
[3] Jean-Paul II, Centesimus annus (1991), 5.
[4] Ceras, Le discours social de l’Église catholique : de Léon XIII à Jean-Paul II. Paris, Le Centurion, 1984. Rééditions augmentées et actualisées en 1994 et 2009
[5] Paul VI, Octogesima adveniens (1971), 4.
[6] Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis (1987). 3.
[7] François, Laudato si’ (2015), 15.
[8] Luc Dubrulle, « L’enseignement social de l’Église : qu’est-ce que c’est ? », dans Service National Famille et Société de la Conférence des évêques de France, Notre bien commun 1. Paris, L’Atelier, 2014. p. 21.