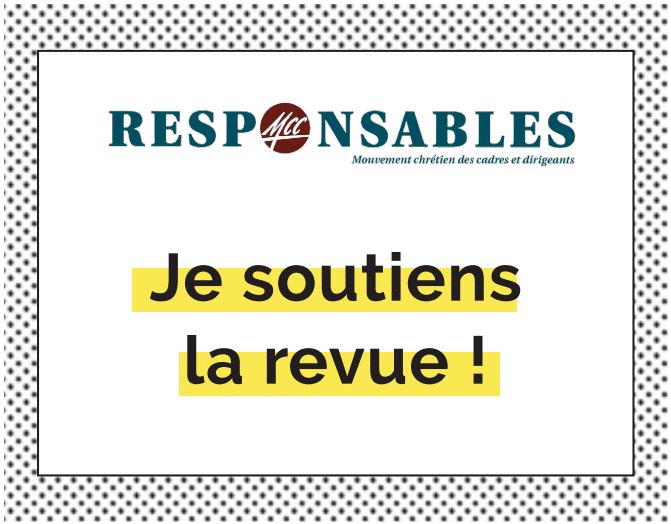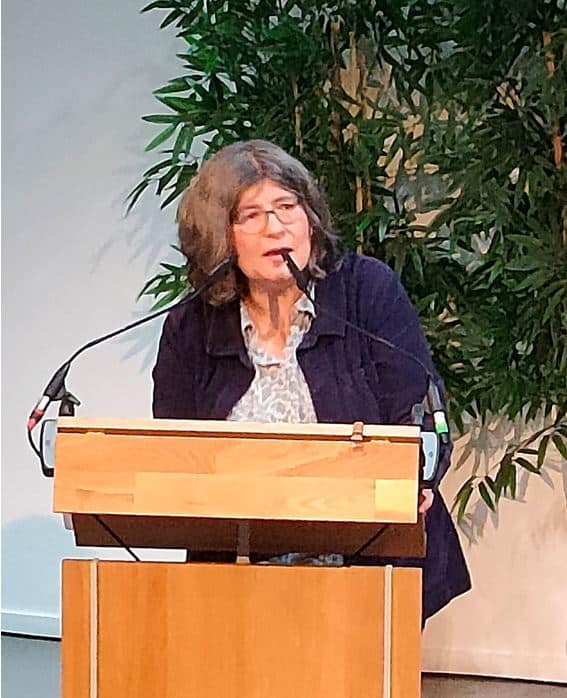
Béatrice Oiry
Maître de conférence en exégèse biblique à l’institut catholique de Paris
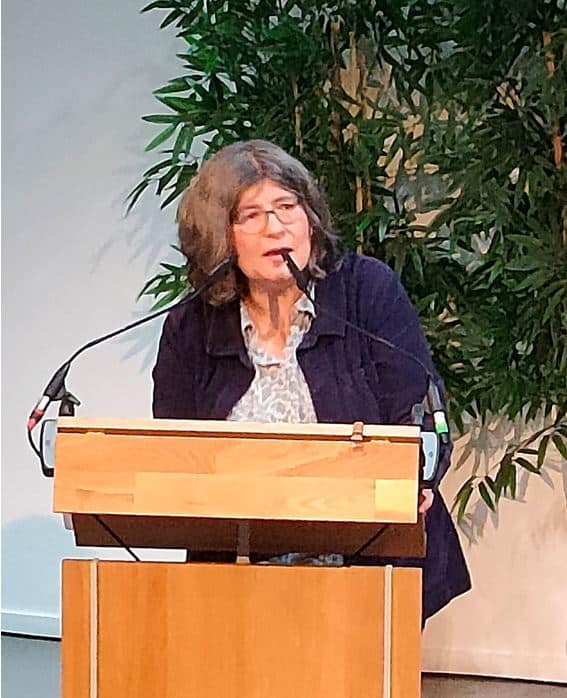
Béatrice Oiry
Maître de conférence en exégèse biblique à l’institut catholique de Paris
regard spirituel
Temps de lecture estimé : 8 minutes
Le livre de l’Exode ou comment mettre des limites au travail
Retour sur l’intervention de Béatrice Oiry lors la rencontre annuelle des Semaines sociales de France de 2024, sur le thème du travail dans la Bible. Focus ici sur le livre de l’Exode.
De la première à la dernière page, le livre de l’Exode déploie toute une réflexion autour du travail, de ses formes et des conditions de son exercice.
Lire aussi : Le travail dans le livre de la Genèse : l’homme au chevet de la terre
Commençons par un petit point de vocabulaire. En hébreu, le mot que l’on traduit par “travailler” est ‘avad. Ce mot signifie “travailler”, mais aussi “servir”, “être esclave” et même “accomplir un rite liturgique”. Or, cette racine, dans ses formes verbales et substantivées, est très fréquente dans le livre de l’Exode. On en relève 97 occurrences, ce qui suffit à dire l’importance de la question dans ce texte. Ces occurrences balisent tout un parcours, de la servitude au service, selon l’heureuse formule de l’exégète Georges Auzou.
La sortie de l’esclavage, du travail qui déshumanise
Le point de départ de l’Exode est la situation d’esclavage des Israélites sous la férule du Pharaon. Un travail opprimant où il faut toujours produire davantage, sans limite, sans repos, sous les coups, un travail sous la dépendance d’un despote qui revendique d’être l’égal du Dieu du peuple qu’il asservit. D’emblée, le travail se trouve envisagé par le biais des relations de pouvoir qui s’y exercent souvent, que l’on soit dominé ou dominant. Or, on le sait, la situation d’esclavage des Israélites est ce qui provoque l’intervention de Dieu pour les faire sortir d’Égypte.
Premier élément donc : la sortie de l’esclavage, d’un travail qui déshumanise, de la dépendance envers une autorité qui s’arroge droit de vie et de mort, est la figure première et archétypale du salut dans l’Ancien Testament. Le livre de l’Exode tout entier rapporte la manière dont Dieu conduit le peuple et lui apprend la liberté sous sa propre autorité. L’alliance conclue entre Dieu et le peuple est le cadre qui permet d’articuler la relation d’Israël avec Dieu et secondairement son rapport au travail.
Le sabbat comme limite au travail
L’alliance permet la mise en place de deux garde-fous qui visent à ne plus rendre possible une vie d’esclave. Le premier consiste en une limite mise au travail lui-même. L’alliance proprement dite est un contrat entre deux parties – ici Yhwh et le peuple – qui s’organise autour d’une loi, cette loi, ce qu’on appelle le code de l’Alliance (Ex 20–23).
Ce code est préfacé par ce que l’on appelle le Décalogue (Ex 20, 1–17). Or, celui-ci prescrit : “Qu’on fasse en mémorial du jour du sabbat en le tenant pour sacré. Tu travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, mais le septième jour, c’est le sabbat du SEIGNEUR, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes, où l’émigré que tu as dans tes villes. Car en six jours, le SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l’a consacré.”
L’institution du sabbat pose une limite, elle fixe un rythme où le repos vient régulièrement interrompre le travail. Remarquons d’abord que cette loi concerne toute la maisonnée, serviteurs et animaux compris, c’est-à-dire tous ceux qui peinent au travail. De plus, elle s’adosse sur la mémoire de l’agir créateur de Dieu qui a mis lui-même une limite à son œuvre créatrice dans le monde. Le repos se trouve ainsi inscrit dans le projet créateur, au même titre que le travail.
Le Pentateuque présente une seconde version du Décalogue. Or, celui-ci formule une autre motivation à la loi du Sabbat : “Tu te souviendras qu’au pays d’Égypte tu étais esclaves, et que le SEIGNEUR ton Dieu t’a fait sortir de là d’une main forte et le bras étendu ; c’est pourquoi le SEIGNEUR ton Dieu t’a ordonné de pratiquer le jour du sabbat” (Dt 5,15). Mémoire de l’œuvre créatrice et de sa limitation en Exode, le sabbat se révèle également être pour Israël la mémoire de sa libération d’une servitude invivable.
Faire mémoire, antidote à un retour à la servitude
Le second garde-fou se trouve formulé dans la scène du buisson ardent, au moment même où Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour négocier la libération du peuple. Moïse résiste, il a peur et essaie de se défiler. Il entend alors Dieu lui dire : “Je suis avec toi. Et voici le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple d’Égypte, vous servirez Dieu sur la montagne.” (Ex 3,12) Ici, l’expression “servir Dieu” pourrait être traduite par “vous travaillerez pour Dieu”. Elle fait d’abord entendre un déplacement d’autorité. De peuple asservi à Pharaon, Israël devient peuple du Seigneur.
C’est aussi l’irruption d’une nouvelle forme de travail, car ici, l’expression “servir Dieu” désigne la liturgie. Ainsi, le signe de la libération de l’esclavage donné à Moïse est la promesse d’un peuple réuni pour la célébration du culte sur la montagne. Et de fait, le livre de l’Exode s’achève par la construction du premier sanctuaire qui rend possible la mise en route du culte (Ex 35–40). La liturgie est mémoire du salut, et donc aussi en creux celle de la servitude. Cette mémoire doit être un antidote à un retour à la servitude — ou à l’asservissement de l’autre — comme le rappelle un ensemble de lois.
Le fruit du travail, don pour la vie
Elle est aussi un service de Dieu, une reconnaissance de l’autorité sous laquelle le peuple choisit de se mettre. Non pas un tyran humain, mais le roi du Ciel, le transcendant qui ne se laisse ni voir ni manipuler. Et la liturgie et la forme que prend le service de l’homme à l’égard de son Dieu-roi. Enfin, la liturgie est une limite mise au travail en tant qu’elle évite à celui-ci de se clore sur sa logique productiviste.
Les offrandes végétales et animales tiennent une place importante dans la liturgie d’Israël. Ce sont les fruits de son travail que le peuple offre. Le rituel d’offrande des prémices de la récolte notamment (Dt 26,1–11) permet de raviver la conscience, au début de la saison de moisson, que tout ce que la terre produira est un don de Dieu, et par cette offrande, lui est symboliquement retourné. Récoltant le fruit de son travail, Israël doit le recevoir non comme son dû mais comme un don pour sa vie.
La liturgie introduit donc dans le travail une dimension de dépossession et de la reconnaissance d’une altérité. Les offrandes des récoltes, des animaux du troupeau sont une manière de donner au travail une orientation, une finalité autre que la production ou le commerce. Une part est offerte à l’Autre, elle doit l’être aussi au pauvre. Car Dieu est certes le premier destinataire des offrandes, mais les prophètes savent rappeler que celles-ci n’ont aucune valeur si elles ne sont pas accompagnées d’un partage avec le pauvre. Si l’ordre éthique n’est pas respecté, si la justice n’est pas pratiquée, si les biens ne sont pas équitablement répartis, alors d’offrande liturgique n’a aucun sens, c’est une caricature.
La dépossession et la gratuité, reconnaissance d’une altérité
Le livre de l’Exode mène donc une exploration de la condition du travailleur serviteur, qui consiste essentiellement à mettre des limites au risque d’un rapport au travail vécu sous la modalité de l’asservissement, de l’abus de pouvoir ou de la seule logique de possession. Le repos est à la fois la prise en compte de la finitude des êtres vivants et une limite mise à une production sans fin. L’existence ne peut être tout entière enclose dans le travail et dans ses logiques possiblement dévorantes.
La finale liturgique du livre manifeste d’abord un changement de maître, du pharaon despote au Dieu libérateur et transcendant. Elle inscrit aussi dans le travail une dimension de gratuité et de démaîtrise qui, là encore, prévient le risque de clôture.
Pour en savoir plus : voir les actes de la rencontre annuelle 2024 des Semaines sociales de France, avec une analyse complémentaire sur l’évangile de Matthieu.