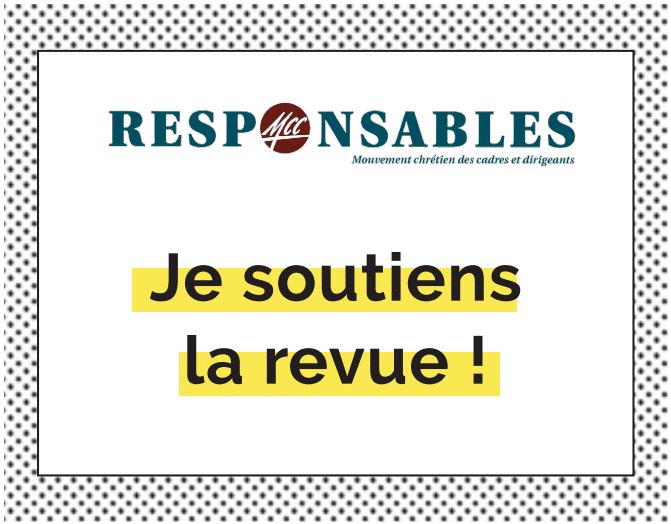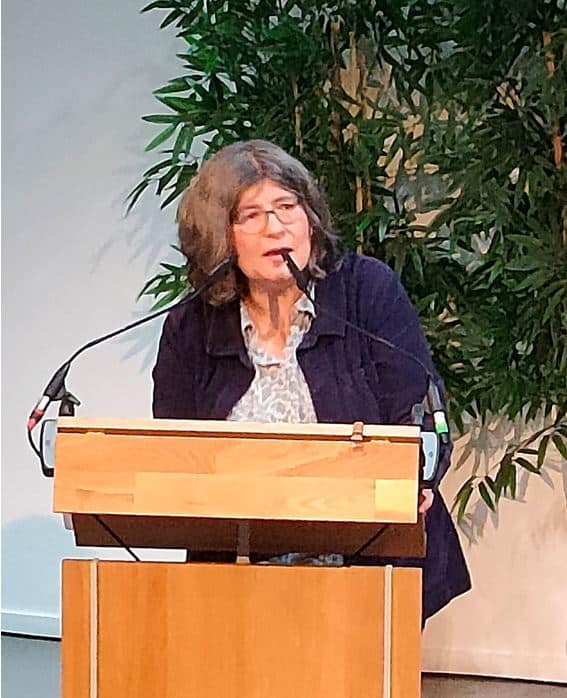
Béatrice Oiry
Maître de conférence en exégèse biblique à l’institut catholique de Paris
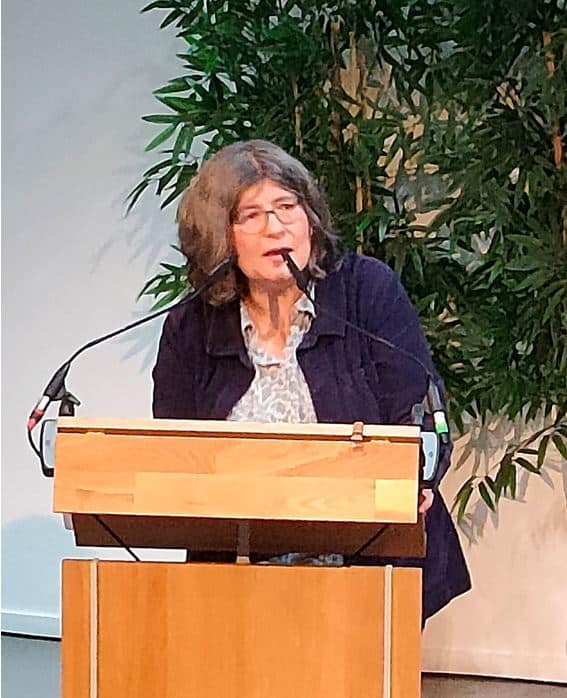
Béatrice Oiry
Maître de conférence en exégèse biblique à l’institut catholique de Paris
regard spirituel
Temps de lecture estimé : 10 minutes
Le travail dans le livre de la Genèse : l’homme au chevet de la terre
Retour sur l’intervention de Béatrice Oiry lors la rencontre annuelle des Semaines sociales de France de 2024, sur le thème du travail dans la Bible. Focus ici sur le livre de la Genèse.
Disons-le d’emblée, sur le travail, comme sur de nombreuses questions qu’on lui pose, la Bible n’a pas de discours univoque, pas plus qu’elle ne développe un propos systématiquement construit. Le travail est cependant une réalité très présente dans les textes bibliques, de l’Ancien et du Nouveau Testament. Les textes bibliques parlent peu du travail, mais ils mettent souvent en scène des travailleurs, ils évoquent des situations de travail.
Lire aussi : Le livre de l’Exode ou comment mettre des limites au travail
En général, ces situations sont le lieu d’une élucidation sur ce qui est engagé par le travail, à savoir une certaine manière de considérer et de traiter les êtres humains, un certain type de rapport à la vie, mais aussi aux biens et à la richesse, au pouvoir et bien sûr à Dieu. La situation de travail est le lieu d’un discernement sur ce qui oriente l’existence et sur ce qui habite le cœur. Je vous propose de prendre la mesure d’un lien étroit dans l’Ancien Testament entre condition humaine et travail.
Les humains, images de Dieu
Commençons par le commencement, c’est-à-dire par ses inépuisables récits d’origine au début du livre de la Genèse : celui de la création du monde en sept jours (Gn, 1,1–2,3), suivi du récit de l’homme et de la femme dans le jardin d’Eden (Gn, 2–3). Ces récits conduisent une réflexion fondamentale sur la condition humaine dans sa relation avec Dieu et avec le monde.
On le sait, l’homme et la femme sont d’abord créés “à l’image de Dieu” (Gn, 1,27). L’expression “image de Dieu”, dans les cultures du Proche-Orient ancien, peut renvoyer à deux choses : soit elle désigne la statue par laquelle la divinité est présente dans le Temple (dans le culte de Babylone par exemple), soit elle se rapporte au roi qui est, pour son peuple, l’image de la divinité, le médiateur de sa présence. Le récit biblique transpose cette expression pour l’appliquer à tout être humain, et il le fait au moment même où il raconte la création de cet humain, homme et femme.
L’expression “image de Dieu” peut alors être comprise comme un double énoncé sur la condition fondamentale des hommes et des femmes : en premier lieu, le Dieu biblique, le Dieu vivant, n’est pas présentifié par une statue, il l’est par les êtres vivants, par chacun, par chacune. Les humains sont la médiation première de sa présence au monde. Et puis, ces êtres humains, hommes et femmes, sont en quelque sorte des rois dans le monde, c’est-à-dire qu’ils reçoivent du Dieu qu’ils représentent une délégation de son autorité “royale”, autrement dit une charge de gouvernance sur la communauté des vivants. On pourrait donc dire que leur être au monde est d’emblée politique, d’emblée en responsabilité.
Remarquons aussi que la première fois qu’il est question des êtres humains dans le récit biblique, c’est relativement à Dieu. Ils sont exclusivement envisagés par rapport à lui, en vis-à-vis pour ainsi dire, “hommes et femmes à son image”. Et c’est cette expression qui peut permettre d’inférer un certain type de relation au monde. Le travail n’est pas ici explicitement évoqué.
“Il n’y avait pas d’homme pour travailler la terre”
Le récit qui suit, l’histoire de l’homme et de la femme au jardin, reprend les choses par un autre biais. Dans la suite du grand récit d’ouverture en “mondiovision”, ce récit opère comme un zoom sur la condition humaine. De plus, il déploie un autre scénario de création dans lequel les humains ne sont pas créés les derniers comme précédemment, mais les premiers.
Le récit s’ouvre ainsi : “Au jour où Yhwh Dieu fit terre et cieux, il n’y avait encore aucun buisson des champs sur terre, et aucune herbe des champs n’avait encore poussé car Yhwh Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’existait pas d’homme pour travailler le sol” (Gn ‚4–5). Image inaugurale d’une terre déserte et sèche, car herbes et buissons ne sont “pas encore”. Cet adverbe suggère une terre capable de féconde mais en attente. En attente car deux conditions manquent pour qu’elle fructifie : “Yhwh Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’existait pas d’homme pour travailler le sol”.
Ce verset appelle plusieurs remarques. D’abord, le récit s’ouvre par une attention à la terre, c’est elle qui est considérée, elle est en quelque sorte au centre et c’est relativement à elle que l’homme est envisagé, ou plutôt que l’homme et Dieu sont envisagés. Car la fructification de la terre dépend d’une coopération entre les deux. Ils semblent ici convoqués ensemble “à son chevet”, si je puis dire, l’un comme dispensateur de la pluie vivifiante, l’autre précisément comme travailleur.
“Il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol”. Ce n’est pas l’homme qui manque au début de ce récit, mais plus précisément l’homme en tant qu’il est travailleur, et la proposition finale “pour travailler le sol” détermine ici qui il est. Ce lien intrinsèque, originaire, entre l’homme et le sol, entre l’humain et l’humus — l’Adam et l’Adamah, en hébreu — est corroboré par le mode de création de l’homme : il est, on le sait, façonné de la poussière du sol par les mains d’un Dieu potier (Gn 2,7).
L’homme, intendant de la terre
Puis le récit poursuit : “Et Yhwh Dieu prit l’homme, et il l’installa dans le jardin d’Eden pour qu’il le travaille et qu’il le garde.” (Gn 2,15) Les deux verbes “travailler” et “garder” sont de grande importance. À propos du premier, il faut d’abord noter que l’hébreu ne connaît qu’un seul mot là où le français distingue “travailler” et “servir”. Une seule réalité donc en hébreu, l’homme travaille la terre, il est à son service. Le second verbe “garder” évoque les figures du berger qui prend soin du troupeau ou du veilleur qui guette sur le rempart de la ville. Il implique donc soin, attention, vigilance. Ces deux verbes disent à nouveau combien, dans le ce récit, l’homme est envisagé comme celui qui est tourné vers la terre, qui lui est relatif au sens où sa raison d’être est de la travailler selon les modalités du service et du soin — c’est ce que l’on appellerait dans la doctrine sociale de l’Église, et en particulier dans son volet écologique, “l’intendance”, l’homme comme intendant de la terre.
Ainsi, le deuxième chapitre de la Genèse dresse-t-il le portrait d’un homme tiré de la terre et voué à son service. Ce soin du créé qui passe par le fait de travailler la terre appartient pleinement, constitutivement dirais-je, à son être au monde. Autant le premier récit envisageait l’homme relativement à Dieu, autant ici c’est relativement à la terre qu’il est présenté dans le récit, en agriculteur penché vers le sol.
Mais notons qu’à ce point du récit, le travail — ou plus largement l’activité humaine — n’est pas marqué de pénibilité. La logique du mythe permet de faire apparaître ce qui pourrait être le cœur du travail, ce que dans l’idéal, il est ou devrait être, une participation harmonieuse au déploiement de la vie, à la fécondité de la terre et à la nourriture de tous. Car ces récits sont issus d’une culture agricole et pastorale où l’économie est de subsistance et où le travail est ce qui permet de nourrir la maisonnée. Au-delà de cette nécessité, le travail d’une terre qui n’attend que l’homme pour déployer sa fécondité et où cet homme est créé pour être à son service offre l’image d’un travail harmonieusement intégré à l’ordre du créé et au service de son développement d’ensemble.
Travail et éthique
Mais le propos biblique sur le travail ne s’arrête pas là, car le travail tel que l’expérimentent les Israélites dans leur vie quotidienne n’est pas seulement l’heureux service du jardin ou le geste qui permet la venue du royaume. Le travail est aussi un lieu de peine, de conflit, de violence, d’injustice. Il se révèle marqué d’une ambivalence. L’histoire de l’Adam au jardin s’achève, on le sait, par des malédictions. Créé, on l’a vu, comme “travailleur du sol”, c’est précisément sur cette condition de travailleur que porte la malédiction. Ceci est d’ailleurs un indice supplémentaire que le travail est la pierre d’angle de l’anthropologie de ce récit : “ Dieu dit à l’Adam : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre que je t’avais interdit en disant : “Tu n’en mangeras pas”. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine tu en mangeras tous les jours de ta vie. Epines et chardons il fera germer pour toi et tu mangeras l’herbe des champs. A la sueur de tes narines tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes au sol. De lui, tu as été pris car de lui tu as été pris ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras.” (Gn 3, 17–19)
Le récit s’achève donc sur la perspective d’un sol devenu plus difficile à travailler et moins fécond et par conséquent d’un travail marqué par la pénibilité qui ne fournit qu’un régime alimentaire appauvri, sans parler de l’horizon de la mort qui se trouve ici posé. La cause en est la consommation du fruit de l’arbre interdit. Cet arbre, nous le savons, est l’arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement dit l’arbre de l’éthique.
Pour faire vite, disons que l’interdit posé sur cet arbre signifie que la détermination du bien et du mal, autrement dit la source de la loi, ne relève pas d’une décision de l’Adam. Sa vie dans le jardin, sa vie comme travailleur, est placée sous un ordre éthique et la transgression de cet ordre affecte sa condition originelle. Le travail devient alors un lieu d’ambivalence. Effectué dans le respect de la loi, c’est-à-dire accompli avec justice, inscrit dans une éthique, il est porteur de vie ; irrespectueux de cette éthique, il est porteur de mort. Les situations de travail peuvent donc être lues comme des explorations du conflit de valeurs dont elles sont la scène. C’est alors moins le travail qui retient l’attention que les modalités de son exercice.
Pour en savoir plus : voir les actes de la rencontre annuelle 2024 des Semaines sociales de France, avec une analyse complémentaire sur l’évangile de Matthieu.